En souvenir d'un chef
emblématique, hôte de la Suisse
Ferenc Fricsay (1914-1963)
par Jean-François Monnard

Le baryton Dietrich Fischer-Dieskau (à gauche) a collaboré avec Ferenc Fricsay pour de multiples projets discographiques, incluant notamment la Flûte enchantée, les Noces de Figaro et Don Giovanni de Mozart, la Neuvième symphonie de Beethoven ou encore le Château de Barbe-Bleue de Bartók. Photo © dg
La chance, c'est aussi d'être prêt à l'heure. Salzbourg, 6 août 1947, une date qui décida de tout l'avenir du chef d'orchestre: Ferenc Fricsay est appelé à remplacer au pied levé Otto Klemperer, pour assumer la création de l'opéra La Mort de Danton de Gottfried von Einem. Il a trente-trois ans et c'est un triomphe qui ne sera pas pour rien dans le démarrage d'une carrière fulgurante. Formé à l'Académie Franz-Liszt de Budapest, comme Fritz Reiner et Antal Doráti, Fricsay a passé onze ans à la tête de l'orchestre de Szeged avant de s'imposer à Berlin et à Munich, loin de sa Hongrie natale, déployant une activité prolifique entre la Deutsche Oper, le Philharmonique et l'Orchestre du RIAS (Rundfunk Im Amerikanischen Sektor), devenu aujourd'hui Deutsches Symphonie-Orchester, et l'Opéra de Bavière dont il fut patron de 1956 à 1958. Né en 1914, il était de la génération des Günter Wand, Leinsdorf, Celibidache, Markevitch, Sanderling, Giulini et Kubelik. Destiné à mourir trop jeune, avec tant de talent en soi, c'est dans l'histoire que désormais Fricsay a grandi, le désignant comme l'une des deux ou trois plus fortes personnalités de la direction d'orchestre du XXe siècle.
Je me souviens l'avoir entendu pour la première (et seule) fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, le 23 mai 1961. Il était déjà un hôte habitué de l'Orchestre de la Suisse Romande, mais c'est la présence du soliste (Wilhelm Backhaus dans le Quatrième Concerto pour piano et orchestre de Beethoven) qui m'incita, ce soir-là, à me rendre au concert. J'ai gardé l'image d'un chef habité de l'enthousiasme et de la grâce. Mais il aura fallu ses disques et les vidéos sorties des archives pour réveiller ce qui était resté enfoui au fond de ma mémoire. Très vite, le DVD a montré son travail de répétition très exigeant, qui fera plus tard de Carlos Kleiber son alter ego. Fricsay a eu naturellement la chance d'être à l'heure pour le disque. Il a laissé pour Deutsche Grammophon un catalogue discographique important, tant avec l'Orchestre du RIAS qu'avec le Philharmonique de Berlin. Dans le legs que constituent les nombreuses bandes publiées post mortem est le trésor: on y trouve des symphonies de Mozart et de Beethoven interprétées avec un souci mélodique exceptionnel. Mozart et Beethoven étaient ses dieux, Mozart dont il disait que la compagnie rendait l'homme meilleur; et Beethoven, de bout en bout moteur constant d'une exaltation vitale, auquel il a consacré des programmes entiers.
Un autre compositeur que Fricsay s'était choisi: Brahms, dont les Danses hongroises le rapprochaient de son sol natal. Mais au coeur de son répertoire étaient inscrits Bartók et Kodály. Du premier, il a réalisé des enregistrements historiques, le Concerto pour orchestre, le Château de Barbe-Bleue et les deux derniers Concertos pour piano et orchestre ont été récompensés d'un Grand Prix du disque; du second, il a créé la Symphonie en ut, dédiée à la mémoire de Toscanini, au Festival de Lucerne. Dans un entretien avec Wolfgang Geiseler, Fricsay racontait avoir grandi avec la musique de Kodály, étroitement liée à son pays natal. Mais il faut souligner également que Fricsay a défendu les grands compositeurs allemands d'après-guerre (Werner Egk, Boris Blacher, Karl Amadeus Hartmann, Wolfgang Fortner, Hans Werner Henze) dont il a mis et remis avec acharnement les oeuvres sur le métier. Qu'aurait dirigé Fricsay s'il avait pu durer jusqu'à la fin du siècle quand la plupart de ses contemporains étaient encore en vie? Tout le désignait pour qu'il soit brucknérien. Peu avant sa mort, il étudiait la Huitième Symphonie. Et puis, on attendait Mahler. L'enregistrement de la Première et de la Quatrième Symphonie avait été planifié. Projet d'autant plus intéressant que dans les années cinquante, Mahler n'était pas à l'ordre du jour. Seuls quelques chefs comme Jascha Horenstein ou Paul Klecki prenaient l'initiative de le mettre à l'affiche de leurs concerts et devant les micros. A New York, Leonard Bernstein, partageant le pupitre avec Bruno Walter et Dimitri Mitropoulos, dédiait en 1960 un festival à celui qui l'avait précédé au début du siècle à la tête du New York Philharmonic. A Berlin, ce n'est qu'après la parution de l'enregistrement de la Neuvième Symphonie, réalisé par John Barbirolli et l'Orchestre Philharmonique en 1964, que la musique de Mahler apparaît peu à peu dans les programmes d'Herbert von Karajan.
Le geste
Pour décrire la manière de Fricsay, il faut d'abord observer le geste et l'énergie foudroyante qui en émane. Volontaire, efficace, en accord parfait avec la conception musicale, il répond à la pulsation interne qui le commande. Avec lui, le rythme jaillit, investit par contagion tout l'orchestre. On peut parler d'un effet magnétique. A cet égard, la fameuse répétition de la Moldau filmée à Stuttgart en 1960 (le DVD existe) met en valeur un sacré tempérament: «Il y a le moment unique de la danse villageoise que des musiciens allemands ont la tendance d'exécuter comme un Laendler, au risque de dénaturer la vraie inspiration de Smetana. Fricsay les prie, avec une politesse exquise et non sans drôlerie, de se souvenir qu'il vient lui-même de l'Europe centrale et que les rythmes de la musique populaire tchèque ne sont pas ceux des danses allemandes. Il chante cette musique, en soulignant son allure naturelle. Et, peu à peu, après plusieurs essais, le résultat est là, lumineux, convaincant, revêtu de toute la force de l'évidence.»
Cela rappelle la rencontre entre Ravel et Grieg à Paris, dans la maison du compositeur franco-norvégien William Molard, qui fut marquée par une anecdote amusante. Tandis que les conversations allaient bon train entre les convives, «Ravel alla sans bruit jusqu'au piano de Molard et se mit à jouer l'une des Danses norvégiennes du maître. Grieg écouta en souriant, puis commença à manifester des signes d'impatience avant de se lever soudain et de dire d'un ton tranchant: 'Non, jeune homme, pas du tout comme cela. Bien plus de rythme. C'est une danse populaire, une danse paysanne. Il faudrait que vous voyiez les paysans chez nous, avec le violoneux qui tape du pied en mesure. Recommencez!' Et tandis que Ravel jouait, le petit homme sautillait et bondissait à travers la pièce, à la grande stupéfaction de l'assemblée.»
Théâtralement, la répétition de la Moldau avec Fricsay est une véritable leçon de direction. Il y fait passer sa joie de vivre et de travailler (car c'est bien de cela qu'il s'agit) avec un enthousiasme contagieux et stimulant, s'employant avant tout à persuader, convaincre, entraîner chacun dans son sillage. «Parler, bien dire, ici sont musique déjà; le geste ne dure ni plus ni moins que ce que dure le son produit, l'inflexion, l'expression, dans une vérité de concordance toute cinématographique». Cela saute aux yeux: Fricsay est compréhensible pour les musiciens et, malgré la rigueur et l'autorité, tout se passe dans un climat de bonne humeur et de confiance mutuelle...
Pour lire la suite...
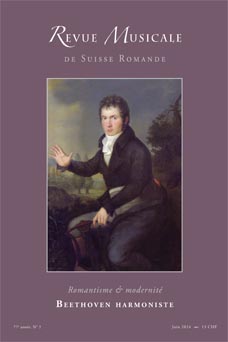
La version gratuite de cet article est limitée aux premiers paragraphes.
Vous pouvez commander ce numéro 77/2 (juin 2024, 64 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):
(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)
Retour au sommaire du No. 77/2 (juin 2024)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite